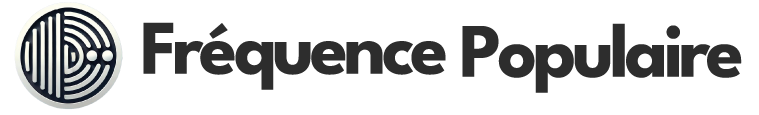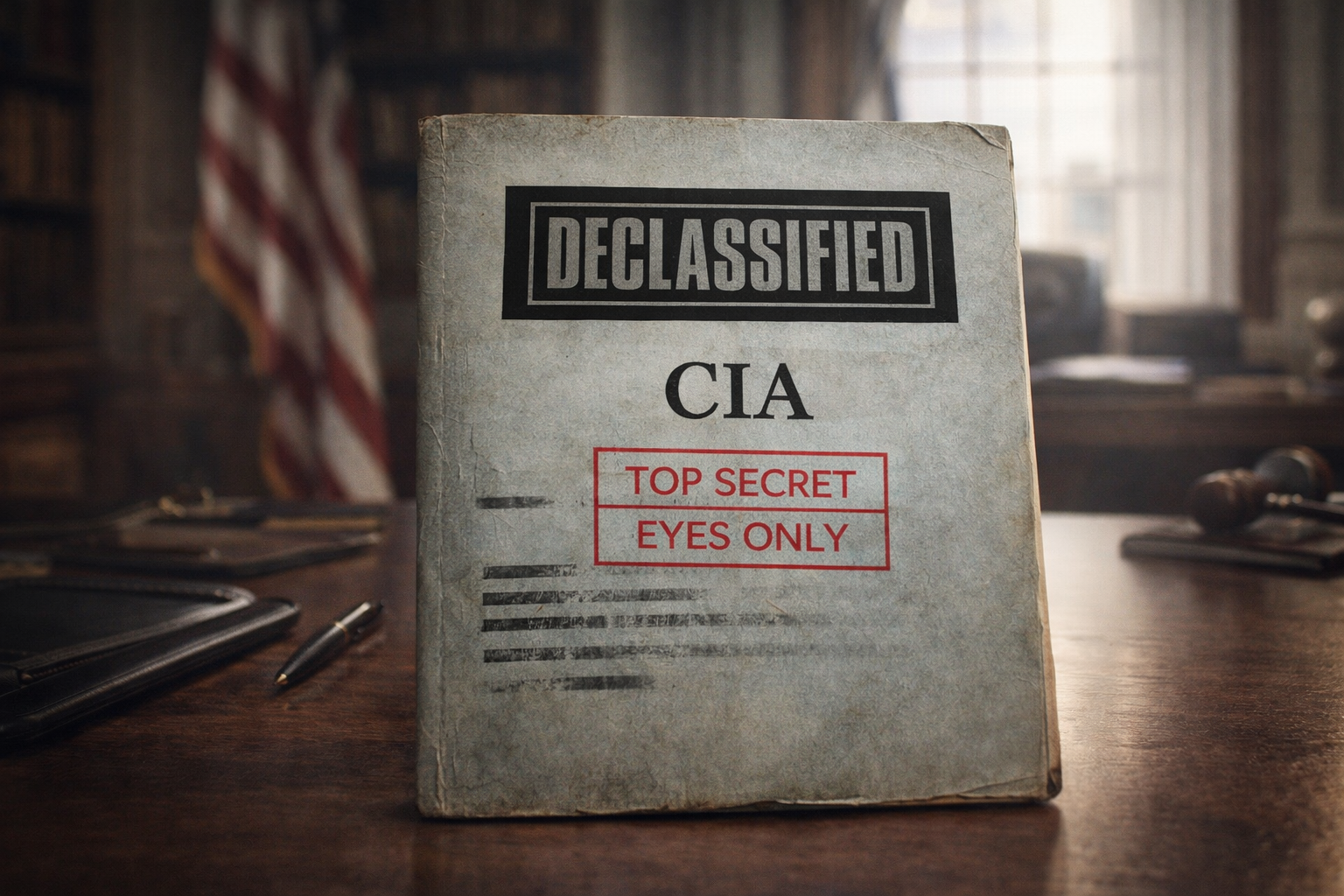L’un des arguments les plus souvent avancés pour prouver la supposée faillite du pouvoir bolivarien s’appuie sur un chiffre largement répandu dans les médias et la politique occidentale : l’exode vénézuélien. Près de huit millions de personnes auraient quitté le pays depuis 1999, soit environ un quart de la population. Pris seul, ce chiffre impressionne. Il n’est ni neutre ni anodin. Mais sans contexte, sans comparaison ni perspective historique ou géographique, il ne permet pas de conclure automatiquement à l’effondrement d’un État, d’un régime ou d’un projet politique. Comme souvent, un chiffre brut, sorti de son contexte, ne reflète pas la réalité : il construit un récit.
La première erreur consiste à isoler le Venezuela de son contexte régional. Si l’on place l’émigration vénézuélienne dans le contexte de l’Amérique centrale et des Caraïbes, elle reste importante, mais n’a rien d’exceptionnel. Depuis les années 1990, plusieurs pays de la région affichent des taux d’émigration similaires ou supérieurs : El Salvador approche ou dépasse 40 %, la Jamaïque atteint presque 38 %, le Guyana dépasse 50 %, et certains petits États caribéens ont même plus d’émigrés que d’habitants. Pourtant, ces pays ne sont pas systématiquement présentés dans les médias comme des États illégitimes ou en déclin. La raison est simple : admettre que l’exode n’est pas propre au Venezuela reviendrait à reconnaître qu’il s’agit d’un phénomène régional, lié à l’histoire migratoire, aux déséquilibres économiques, à la proximité des États-Unis et à l’attraction exercée par la première puissance mondiale sur ses voisins.
Read the full article
Sur Fréquence Populaire, il n’y a pas de mur payant (paywall) : tous nos articles sont accessibles gratuitement.
Nous vous demandons simplement de créer un compte gratuit avec votre adresse e-mail.
Cela nous permet de :
– vous prévenir de nos nouvelles enquêtes, émissions et articles,
– éviter la publicité et tout pistage intrusif,
– mieux comprendre combien de personnes nous lisent réellement.
Contribuer financièrement est facultatif : vous pouvez lire l’article sans payer. Mais si vous le pouvez, votre soutien nous aide à faire vivre un média libre et indépendant.
Créer un compte gratuit